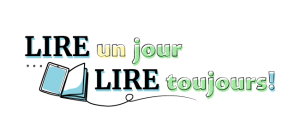
Cliquez ici pour accéder à la transcription de cette vidéo
Des ressources supplémentaires en lien avec ce projet sont disponibles ici
Par Carole Fleuret, Professeure titulaire, faculté d’Éducation à l’Université d’Ottawa
Introduction
Même si cela semble être de l’ordre de l’évidence, il faut garder à l’esprit que les enfants qui arrivent à l’école n’ont pas tous le même bagage langagier ou les mêmes connaissances de l’écrit. Qu’ils viennent d’ici ou d’ailleurs, l’exposition à l’écrit, la familiarité avec l’écrit, diffère d’une famille à l’autre et d’un pays à l’autre. En effet, on a tendance à tenir pour acquis que la lecture d’un journal ou encore d’un livre est une tendance, voire une habitude universelle, mais, en fait, ce n’est pas toujours le cas. Certains parents ne sont pas des pratiquants de la culture écrite, comme le dit Chauveau (2000). Pour d’autres, il existe des formes de communication qui ne sont pas centrées sur l’écrit, mais plutôt sur l’oral[1], comme nous pouvons le constater, entre autres, chez les immigrants du continent africain (Delebarre, 2022). Dans la société africaine, l’oralité occupe une place de premier plan, car elle favorise le développement psychosocial des enfants, en plus de transmettre des valeurs culturelles et l’environnement dans lequel elles prennent racine (Erete et Olubukola, 2016). En d’autres mots, on peut voir qu’il existe des différences notoires entre les élèves, les environnements familiaux et l’école. Alors, comment peut-on les sensibiliser sur la place et le rôle de l’écrit dans notre société pour mieux les accompagner ?
Pour Chauveau les vrais débuts de l’acquisition du lire-écrire commencent bien avant l’apprentissage formel. Très tôt, lorsque le jeune enfant est exposé à l’écrit, il va réclamer la lecture d’une histoire, interpeller ses parents sur ce qu’ils lisent ou écrivent, réagir à un message écrit à partir d’une image, etc. Bref, à partir des comportements de ses parents, le jeune enfant va tenter de résoudre trois questions qui caractérisent la phase de compréhension :
- Quelles sont les pratiques et les fonctions de l’écrit ? (aspects culturels)
- Comment fonctionne le système écrit, quel est le « code » ? (aspects linguistiques)
- Comment faire pour lire ? (aspects stratégiques : les principales opérations en jeu dans l’acte de lire)?
[1] « La tradition orale est définie comme un témoignage transmis oralement d’une génération à une des suivantes. Ses caractères propres sont la verbalité et la transmission qui diffère des sources écrites ». (Vansina, 1980, p 27).
Les fonctions et les concepts reliés à la langue écrite
Pour amener les jeunes élèves à prendre conscience de ce que représente l’écrit et pour répondre à leurs besoins, le personnel enseignant va les amener à saisir que l’écrit sert à :
1) communiquer; s’informer; informer,
2) exprimer des émotions, des points de vue, etc.
La conscience de l’écrit, aussi appelée clarté cognitive [2] (Downing et Fijalkow, 1984), vise à faire comprendre aux élèves ce qu’est une tâche scolaire, pourquoi elle doit être faite et pourquoi il est nécessaire d’acquérir tel ou tel concept. Pour les auteurs, la clarté cognitive se construit sur trois plans :

Pour Fijalkow, la clarté cognitive vise deux aspects du développement de la compréhension, celui des buts de l’apprentissage (le pourquoi?) et celui des caractéristiques techniques de l’apprentissage (le comment ?). Il est donc important pour engager les élèves dans les tâches scolaires de leur donner la raison de l’activité pour qu’elle fasse sens auprès d’eux, car l’enseignement est souvent fait d’implicites et l’on tient pour acquis que les élèves savent pourquoi ils font telle ou telle activité. Avec des élèves plus fragiles qui risquent d’être en difficulté, la raison de la tâche est encore plus importante pour susciter leur engagement afin qu’ils voient la portée de celle-ci et le chemin qu’il reste à parcourir.
Dans la mesure où ils sont des lecteurs émergents, il est important de leur offrir des occasions pédagogiques qui visent à faire comprendre et à modéliser le fonctionnement de l’écrit, sa technique (correspondance graphème-phonème), c’est-à-dire les concepts de lettre, de chiffre, de phrase, de ponctuation, etc. Par exemple, durant une lecture interactive, en présentant un abécédaire, l’élève va saisir que chacun des sons qu’il entend se traduit par une lettre et que le français est composé de différentes lettres qui, mises ensemble, forment et portent du sens, c’est-à-dire un mot. Pour chaque lettre, l’enseignant va expliciter, en nommant son nom, le phonème qui l’accompagne et donner un exemple de prénom d’enfant de la classe qui commence par ce son ou un objet que leur familier. Les élèves vont aussi comprendre que la longueur ou la taille des mots n’est pas proportionnelle à l’objet (ex. : le train ou encore coccinelle), ce qui relève du traitement figuratif des mots.
Lorsque l’enseignant fait la lecture aux élèves, il est important de présenter tout ce qui se trouve sur la première de couverture, de rendre explicites le titre, l’auteur, l’illustrateur et la maison d’édition et d’expliquer le rôle de chacun. Très vite, en plus d’apprendre le métalangage relatif au livre, les élèves vont exprimer leurs goûts en matière d’auteurs ou d’illustrations, car ils les reconnaissent. En favorisant le plaisir de découvrir la lecture et leurs propres goûts, se met aussi en place, en plus de comprendre l’utilité de la lecture, la motivation intrinsèque. Le rôle de l’enseignant est primordial pour instaurer une atmosphère propice à l’échange, surtout face à des enfants peu socialisés à l’écrit. Cette atmosphère est aussi l’espace dans lequel vont être mises en commun et s’organiser les relations affectives, intellectuelles et sociales à travers le dispositif de lecture (Fleuret, 2023).
[2] Voici d’autres références sur la clarté cognitive : https://shs.cairn.info/revue-recherches-en-didactiques1-2014-2-page-45?lang=fr
Giasson, J. (2011). La lecture: apprentissage et difficultés. Gaétan Morin.
Comment créer un environnement propice pour le lecteur émergent en maternelle?
Pour faciliter l’entrée dans l’écrit, l’environnement physique de la classe doit être propice au développement de l’enfant, notamment par le jeu (Charron et al. 2022), des coins variés (jeux symboliques, lecture, etc.). Toutes ces occasions suscitent la socialisation par les interactions langagières initiées, mais elles permettent aussi à l’élève de comprendre, par exemple, le rôle de la prosodie quand sa voix monte lorsqu’il pose une question au vendeur durant du jeu symbolique de la marchande. Pendant ce jeu, il va aussi se rendre compte que, sur les étiquettes des aliments, il y a une image et donc le sens peut se représenter sous une forme picturale, mais aussi par une orale et écrite. Ce constat le conduira à comprendre le lien entre l’oral et l’écrit pour exprimer un sens.
Pour les élèves allophones qui sont familiers avec une autre écriture, ce type d’activités leur permet de se familiariser avec le sens de la lecture en français et avec les caractères avec lesquels ils ont écrit. Il peut être intéressant, compte tenu des origines diverses des élèves, de profiter des prénoms de la classe, car ils occupent une place affective particulière, pour les exposer aux différentes écritures. Les parents, par exemple, peuvent écrire le prénom de leur enfant dans leur langue d’origine et, par la suite, l’enseignant les disposer au tableau à la vue de tous les élèves. Il leur explique que d’autres signes peuvent servir d’écriture dans d’autres langues. Les élèves peuvent chercher les points de ressemblance et de différence. Cette activité peut aussi être réalisée en 1re année.
Comme il est toujours préférable de travailler la lecture et l’écriture conjointement, car ce sont deux faces d’un même objet, à partir d’un contexte authentique comme celui d’un jeu symbolique ou d’un album de littérature de jeunesse, l’enseignant peut proposer une tâche d’orthographes approchées. L’idée n’est pas d’amener les élèves à écrire les mots de façon orthographique, loin de là, mais plutôt de les amener à exprimer leurs connaissances de la langue écrite, c’est une façon de les immerger. L’enseignant conservera les traces et reviendra en grand groupe sur l’écriture attendue, mais en aucun cas n’évaluera la production de l’élève. Ce que l’on veut ici c’est que les élèves prennent du plaisir à découvrir l’écrit afin que cela soit moins anxiogène pour eux, surtout s’ils sont familiers avec une autre écriture.
Comment créer un environnement propice pour l’apprenti-lecteur en 1re et en 2e ?
Pour que l’environnement soit aussi favorable à l’enfant et à ses premiers pas vers la langue écrite, il est nécessaire de partir d’un contexte authentique. De cette façon, les élèves sont capables de lier le contexte à la tâche demandée. Sur le plan de la différenciation pédagogique, les activités proposées seront donc variées et répondront à différentes entrées cognitives qui facilitent la lecture et l’appropriation du code graphique. Par exemple, la première peut être la lecture de mots à l’unisson, ceux qui ont été abordés durant la lecture pour renforcer la conscience phonologique. Ils peuvent, par la suite, être travaillés à l’écrit par les orthographes approchées [3]. L’enseignant peut demander aux élèves d’écrire des phrases ; c’est une façon de voir s’ils ont compris le sens des mots. Il peut aussi donner un court texte avec des phrases trouées pour valider la compréhension. Pour mettre en place une représentation mentale des lettres et de leur forme, on peut envisager une activité individuelle de traçage dans du sable (dans une boîte à chaussures), ou encore, celle de former des lettres avec de la pâte à modeler. En passant dans les rangs autour des îlots, l’enseignant peut voir les lettres qui sont à renforcer. L’enseignant demande aux élèves de tracer la lettre A. Cette activité peut aussi se faire en grand groupe à partir d’un tirage au sort de la lettre et de l’équipe.
Pour les élèves qui semblent avoir des connaissances plus fragiles ou qui ont du mal à se représenter ce que signifie l’écrit, il est nécessaire de renforcer la discrimination phonologique, car elle est essentielle pour reconnaître la chaîne sonore, pour isoler des syllabes puis des mots, ce qui conduit au décodage, indispensable à l’automatisation des mots qui conduit à la fluidité en lecture (Montésinos-Gelet, Fleuret, 2022). Les élèves allophones doivent développer un nouveau répertoire phonologique, il est donc important de travailler cette dimension pour favoriser la lecture des syllabes et le décodage des mots.
Le tracé des lettres est aussi à renforcer chez ces élèves pour qu’ils acquièrent la connaissance des lettres et leur signification orale.
Pour les élèves qui ont besoin d’appui supplémentaire, il est important de ne pas refaire ce qui a été fait en classe, mais plutôt de varier les stratégies que nous proposons pour leur donner accès de façon différente à la mémorisation. Quant au choix des groupes, l’enseignant décidera s’il préfère un groupe homogène pour travailler un aspect particulier ou s’il souhaite mettre en commun des stratégies différentes avec un groupe hétérogène.
[3] Voici différentes ressources su=i vous souhaitez approfondir cette approche :
Prévost, N. & Morin, M.-F. (2008). Les orthographes approchées : une voie pour réfléchir sur la langue écrite. Québec français, (150), 64–65 : https://www.erudit.org/fr/revues/qf/2008-n150-qf1099697/44009ac.pdf
Harnois, M-J. (2022) Les six étapes des orthographes approchées. https://www.youtube.com/watch?v=cAQ8nzIAyXM
Montésinos-Gelet, I. et Morin, M-F. (2006). Les orthographes approchées. https://www.cheneliere.ca/fr/orthographes-approch-es-d-marche-souteni-9782765011194.html
Références bibliographiques
Explorez-en le site du CCJL : https://lireunjour.ca/
Chauveau, G. (2000). Des apprentis-lecteurs en difficulté avant six ans. Revue Tranel, 33, 35-44.
Charron, A., Bouchard, C., Villeneuve-Lapointe, M. et Parent, A.-S. (2022). Pratiques déclarées d’enseignantes et d’enseignants à l’éducation préscolaire cinq ans en matière de soutien au développement langagier des enfants. Éducation et francophonie, 50(1). https://doi.org/10.7202/1088541ar
Delebarre, J. (2022). Explorer le rapport à l’écrit en français langue seconde par une approche diachronique et contextualisante : Le cas d’élèves locuteurs de langues africaines de tradition orale. [Thèse de doctorat]. Université Paul Valéry Montpellier 3
Downing, J et Fijalkow, J. (1984, 2020). Lire et raisonner. Privat
Erete, E. O. et Olubukola, A. Q. (2016). La didactisation de la tradition orale des leçons morales dans les écoles secondaires du Nigéria. La revue des études francophones de Calabar, V16, (1)
Fleuret, C. (2023). Repenser les gestes professionnels en contexte de francophonie minoritaire et de diversité ethnolinguistique. Arborescences, (13), 7-17. https://doi.org/10.7202/1107651ar
Montésinos-Gelet, I. et Fleuret, C. (2022). La fluidité en lecture. Dans I. Montésinos-Gelet, M. Dupin de Saint-André et A. Charron (Dir.). La lecture et l’écriture à l’éducation préscolaire et au primaire (p.295-313). Chenelière https://www.cheneliere.ca/14530-livre-la-lecture-et-l-ecriture-t1.html
Vansina, J. (1980). La tradition orale et sa méthodologie. Histoire générale de l’Afrique, 1, 167-190.

Carole Fleuret est professeure titulaire à la faculté d’Education de l’université d’Ottawa. Ses recherches portent sur la didactique des langues secondes, sur les répertoires plurilittératiés et sur le plurilinguisme. Elle s’intéresse à l’appropriation de l’écrit, entre autres, au développement orthographique et aux composantes sociocognitives et culturelles en jeu dans la socialisation à l’écrit auprès des populations minorisées, dans une perspective interculturelle.
